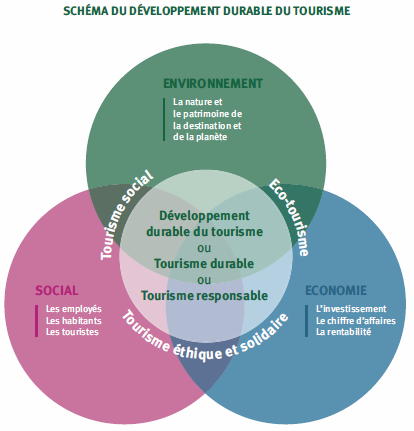Dans cet article, Hephata fait le tour des différents habitats partagés développés dans des sites patrimoniaux en France.
Introduction
L’habitat partagé est un logement communautaire qui présente à la fois des espaces privés (chambres et salles de bain par exemple) et des espaces collectifs (cuisine, salon, jardin, etc., …). On distingue différents types d’habitats partagés : le cohabitât, le béguinage, l’habitat intergénérationnel, le coliving ainsi que l’habitat accompagné. Ces types de logements ont souvent une vocation sociale à destination des individus ayant un accès plus fragile au logement ou souffrant de solitude : étudiants, personnes âgées et/ou handicapées, individus souffrant d’addiction, etc., …
L’habitat partagé est un type d’activité économiquement rentable que peut développer un site historique. Il existe déjà plusieurs exemples en France de ce type de logements inclusifs qui ont ouverts dans des monuments d’exception et des bâtiments anciens. Voici donc quelques exemples de différents habitats partagés développés dans des sites patrimoniaux en France.
Un habitat partagé au sein du château de Panat
Dans la commune de l’Isle-Jourdain dans le Gers, le château de Panat accueille une coopérative d’habitants : l’Alter habitat lislois. Le groupe est constitué de familles avec enfants, de célibataires, de couples, d’actifs et de retraités, etc., … En cours de réaménagement, le château accueille plusieurs logements de dimensions différentes, pouvant ainsi accueillir une ou plusieurs personnes.

© Façade sud du château de Panat (printemps 2019), Clement.aumeunier, CC BY-SA 4.0.
Un habitat partagé dans une ancienne maison bourgeoise du XIXe siècle
A Saint-Brieuc, deux familles ont créé l’habitat partagé de la ville Berno. Les deux couples et leurs enfants débutent les travaux de réhabilitation en 2013 et en 2015, ils remportent un appel à projet lancé par le Conseil Général des Côtes d’Armor. Ils vont ainsi recevoir une aide de 10 000€ pour poursuivre les travaux. Le site comprend quatre logements de différentes dimensions ainsi que des espaces communs servant au stockage et à la vie commune.
Un béguinage à l’hôtel Sivard de Beaulieu
L’hôtel Sivard de Beaulieu à été construit en 1739. Doté de plus de 1000 m² de bâti et de 5000 m² d’espaces verts, il a été transformé en lieu de béguinage pour l’accueil des personnes âgées. Une dizaine de maisons ont également été construites dans l’enceinte du domaine afin de créer des espaces de vie plus indépendants pour les personnes âgées encore tout à fait autonomes. Le coût du projet était de 4,6 millions d’euros mais, tout à fait enthousiasmée, la ville a proposé deux garanties d’emprunt, à hauteur de 50%.

© Hôtel Sivard de Beaulieu, Le Refuge, Valognes, HaguardDuNord, CC-BY 3.
Le coliving dans la Maison Luna
Située à Paris dans le 14e arrondissement, la Maison Luna accueille des étudiants et de jeunes professionnels souhaitant vivre en colocation dans un espace sain et harmonieux. Ancienne maison de maître, elle a été complètement rénovée et aménagée en vue de sa nouvelle fonction. Elle dispose aujourd’hui d’une quinzaine de logements avec leurs salles d’eau et toilettes privatifs. Un jardin, une cuisine ouverte, un salon, une salle TV et une buanderie constituent les espaces en commun.
Un mode de vivre ensemble au château Pergaud
Situé dans la Drôme, le château Pergaud abrite un habitat participatif intergénérationnel. Construit à partir de 1837, le château accueille aujourd’hui le collectif du PeRgo. En plus d’un habitat partagé, le château propose des visites immersives, des évènements, des ateliers et des stages ainsi que des résidences d’artistes dans le but de favoriser l’expérimentation et la création. Le site est également ouvert au woofing et aux chantiers participatifs. Les valeurs et aspirations du collectif sont les suivantes :
- Création et créativité ;
- Joie et épanouissement ;
- Respect et ouverture ;
- Partage et transmission ;
- Intelligence collective ;
- Autonomie et mutualisation.
Une vieille maison et un écrin de verdure ouvert à tous
Près de Montpellier et perdue en pleine nature, une ancienne bâtisse, surplombée d’un château du XIe siècle, est habitée de six résidents souhaitant vivre en communauté. Le site cherche aussi à accueillir des visiteurs de passage. Deux options sont possibles :
- Le woofing qui permet au visiteur de bénéficier d’un logement en échange de menus services (jardinage, ménage, bricolage, etc., …) ;
- Un logement à moindre coût pour venir se reposer et se ressourcer.
Une cohabitation intergénérationnelle au Fort de Montauban
Doté de ses huit hectares, le Fort de Mautauban est un lieu de vie où se côtoient à la fois des personnes âgées et des jeunes, le plus généralement des étudiants. C’est un lieu de vie très dynamique et convivial qui est également ouvert au public. C’est aussi un lieu culturel fort qui propose de nombreux évènements et activités : spectacles, débats, expositions, etc., … Le lieu permet donc de favoriser la mixité sociale et la convivialité et de rompre la solitude des individus, notamment des plus âgés.

Un habitat participatif dans une ancienne ferme viticole
Le domaine de Morlay, en Saône-et-Loire est une ancienne ferme viticole aujourd’hui occupée par un habitat partagé. Cinq familles partagent le lieu dans un objectif social et écologique. S’y développent également des activités ouvertes aux visiteurs et aux autres habitants locaux : équitation, espaces d’hébergement sous la forme de gîtes ou d’un camping, etc., …
La Bergerie de Berdine, ouverte aux personnes fragilisées
La Bergerie de Berdine est perdue dans la nature, au cœur du parc naturel régional du Lubéron, dans un décors provençal unique. C’est un lieu à vocation sociale spécialement dédié aux personnes fragilisées par la vie ou une ancienne addiction. L’association a été créée en 1973 et depuis, elle a accueilli plus de 6500 personnes fragilisées. Ces personnes sont logées pour une durée indéterminée et sans contreparties financières. En échange, elles doivent s’adonner aux travaux de la ferme. Cette manière de vivre est aussi pour elles une manière de suivre un parcours de réinsertion et de réintégration progressif dans la société puis le monde professionnel. En effet, les activités manuelles et agricoles, le contact avec la nature et les animaux les amènent à reprendre confiance en elles et en leurs talents.
Pour aller plus loin
Le tour des sites accompagnés par Hephata en France
Les sites du patrimoine européen à découvrir cet été
Top 5 des lieux patrimoniaux emblématiques marqués par des femmes